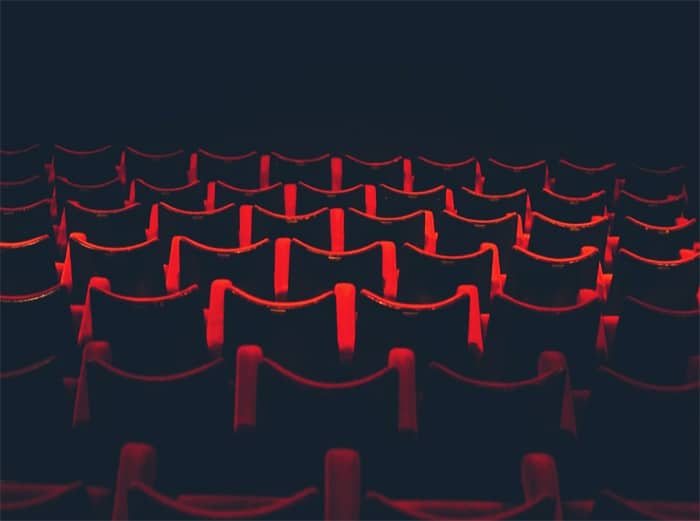Didier Ruiller est toujours revenu à la traduction audiovisuelle et sous-titrage et a décidé de transmettre son expérience aux étudiants de l’ISIT.
Passionné par les langues, Didier Ruiller poursuivit sa formation initiale en entamant des études de traduction à l’ISIT, à Paris, après avoir obtenu son bac scientifique. Avec la fiction et les dialogues comme choix de prédilection, il s’est ensuite spécialisé dans la traduction audiovisuelle. Sa première expérience au sein d’un laboratoire de sous-titrage dans lequel il occupait un poste plutôt axé sur la technique que la traduction lui a permis d’apprendre toutes les ficelles du métier et de se créer un carnet d’adresses.
Tout en gardant le sous-titrage comme principale activité, il se diversifie et s’intéresse à l’édition. Les éditions Flammarion lui confient, à l’époque, la traduction de plusieurs ouvrages tirés de « Sans aspirine », la collection de livres de vulgarisation des sciences humaines sous un angle fun et décalé. Ensuite, il se lance dans l’enseignement, à l’ISIT, où il se donne pour mission de transmettre tout ce qu’on lui a appris sur le terrain et de relever un défi personnel : se confronter à un public. « Animer un cours, c’est être face à une assistance qui a des attentes et qui va vous juger sur ce que vous êtes capable de lui apporter. Et même si vous êtes là avant tout pour partager la passion de votre métier, vous réalisez une performance. Vous devez être captivant, convaincant, stimulant. Si vous êtes mauvais, vous le saurez tout de suite ! », souligne Didier Ruiller. La boucle est bouclée. Pendant dix ans, ce spécialiste de la traduction audiovisuelle et du sous-titrage a donc mené ses deux activités de front : d’un côté la traduction et, de l’autre, l’enseignement.
Dans cette interview avec Cultures Connection, ce mordu de films en VO nous raconte son expérience en tant que traducteur et nous partage sa passion pour l’enseignement.
Vous avez travaillé au sous-titrage de Drive de Nicolas Winding Refn. Quelles étaient les conditions de travail et de confidentialité ?
La consigne de confidentialité, elle est évidente. À partir du moment où un client vous confie l’adaptation d’un long métrage, vous disposez du script et de l’image car on travaille toujours à partir d’une vidéo du film en question. Il est donc clair que nous, traducteurs, sommes tenus de ne rien divulguer. On travaille dans notre coin, sans en parler à personne.
Maintenant, selon le film ou le programme sur lequel vous travaillez, il y a un degré de confidentialité. Sur de très grosses sorties, il y a effectivement certaines dispositions qui sont prises et les traducteurs doivent signer des décharges. Ça m’est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises. Une collègue m’avait même raconté que pour un film, elle avait été obligée de travailler dans les locaux du distributeur pour éviter qu’une copie ou qu’une version du film ne circule.
Cependant, dans la plupart des cas, on travaille de chez soi et le client compte sur notre discrétion pour ne rien révéler ni du film ni de son intrigue. C’est avant tout une relation de confiance avec le distributeur. Il sait que vous n’allez pas pirater le film parce que ça serait le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied.
On dit souvent dans la profession que le meilleur sous-titrage, c’est celui qui ne se remarque pas.
Quelle est la marche à suivre pour que le spectateur puisse profiter du film tout en lisant ?
C’est ce qui fait toute la difficulté et tout l’intérêt en même temps du sous-titrage. Il n’y a rien de pire pour le spectateur que de passer la majeure partie de son temps les yeux rivés sur le bas de l’écran. Le sous-titre doit donc faire office de béquille. C’est-à-dire qu’il est là pour aider le spectateur à suivre le film, mais il ne doit jamais prendre le dessus sur l’image et sur ce qu’il se passe à l’écran. D’ailleurs, on dit souvent dans la profession que le meilleur sous-titrage, c’est celui qui ne se remarque pas. Lorsque vous demandez au spectateur ce qu’il a pensé des sous-titres, s’il vous répond qu’il ne sait pas, ça veut dire qu’ils sont passés comme une lettre à la poste. En fait, tout l’enjeu, c’est de réussir à faire quelque chose qui n’excède pas la lisibilité maximum à laquelle on a droit pour chaque sous-titre, tout en permettant au spectateur de comprendre de façon instantanée ce qui est dit par les acteurs à l’écran. C’est pourquoi on dit souvent qu’il s’agit plutôt d’un exercice d’adaptation que de traduction à proprement parler. On n’a pas la possibilité, en tant que traducteur littéraire, d’avoir recours à la note de traduction. En traduction audiovisuelle ou en sous-titrage, il y a des contraintes de temps et d’espace et il faut que la compréhension du spectateur soit immédiate, notamment lorsque vous travaillez sur des registres très particuliers tels que l’humour.
Prenons l’exemple de l’anglais. Il y a ainsi des choses qui ne passeront pas dans la langue d’arrivée parce que l’humour anglo-saxon ne porte pas sur les mêmes sujets que l’humour français. L’anglais comporte beaucoup de mots très courts, de 3 à 5 lettres, où il suffit de changer une lettre pour changer le sens. L’humour français joue sur un registre différent. En ce moment, je travaille sur des late shows américains et cette différence est assez flagrante : on est vraiment obligés d’adapter. Il y a des choses qui passeront très bien d’une langue à l’autre, mais dès que l’astuce porte sur la phonétique ou l’homonymie, ça se complique nettement. On doit parfois utiliser une astuce très différente de la version originale, tout en gardant à l’esprit que le spectateur compare forcément inconsciemment ce qu’il lit avec ce qu’il entend. S’il y a une différence trop grande entre les deux, ça coince. L’humour, selon moi, c’est la difficulté majeure de ce métier mais aussi ce qui le rend passionnant.
La seconde difficulté auquel nous sommes confrontés, c’est que l’anglais est une langue plus concise et synthétique que le français. Entre l’anglais et le français, on a un coefficient de foisonnement de 20 %, ce qui signifie qu’un texte en anglais donnera un texte plus long une fois traduit en français. On est donc obligés de condenser et de résumer les propos. Si, par exemple, le locuteur en anglais prononce trois phrases, chacune comportant une idée différente, on doit trouver une tournure en français qui va reprendre les trois idées. Dans certains cas, on peut même être amené à sacrifier l’une des trois idées, toujours dans la même optique de clarté et de confort de lecture. Maîtriser l’implicite est essentiel, tout comme savoir jongler avec les synonymes.
Vous avez dirigé le Master Communication Interculturelle et Traduction à l’ISIT. Quels sont les avantages de mêler communication et traduction ?
Lorsque j’étais étudiant, l’ISIT formait exclusivement aux métiers de la traduction et de l’interprétation. On sortait donc de l’école avec un diplôme de traducteur et/ou d’interprète, ce qui me convenait tout à fait car c’était ce que je voulais faire. L’école a ensuite choisi de diversifier sa formation pour répondre à un marché du travail en constante évolution, mais toujours en s’appuyant sur son cœur de métier, à savoir la maîtrise des langues et des sujets interculturels. Elle propose désormais une formation orientée sur la communication et le management interculturels, ce qui permet à des jeunes diplômés de travailler dans d’autres domaines que la traduction pure et simple tels les ressources humaines, le marketing, la communication interne et externe de l’entreprise, et ce, dans leurs différentes langues de travail.
On remarque aussi que ce sont les compétences acquises par nos étudiants lors de leur cursus mais surtout leur expertise linguistique et culturelle qui vont faire la différence sur le marché du travail. Un jeune diplômé sera ainsi parfaitement à même de gérer une équipe hispanophone composée d’un Colombien, d’un Espagnol et de deux Chiliens, par exemple, parce qu’il maîtrise les codes propres à chaque pays, à chaque culture.
Entre l’anglais et le français, on a un coefficient de foisonnement de 20 %, ce qui signifie qu’un texte en anglais donnera un texte plus long une fois traduit en français. On est donc obligés de condenser et de résumer les propos. Si, par exemple, le locuteur en anglais prononce trois phrases, chacune comportant une idée différente, on doit trouver une tournure en français qui va reprendre les trois idées.
Quel scénariste rêveriez-vous de traduire ?
Je ne sais pas. Je marche plus au coup de cœur pour tel ou tel réalisateur. J’ai eu la chance de traduire Drive de Nicolas Winding Refn, ainsi que ses films suivants. C’est un réalisateur dont les films ne sont pas très bavards et qui travaille beaucoup sur l’image, la photo, l’ambiance. J’aime bien ce qu’il fait. Sinon, je n’ai jamais eu la chance de travailler sur les films de Wes Anderson, qui est aussi un réalisateur que j’apprécie beaucoup, mais je serais ravi de pouvoir les traduire. J’aimerais aussi pouvoir réadapter certains grands classiques que l’on voit parfois à la télé et dont la VOST aurait besoin d’un bon coup de chiffon !
Découvrez nos services de traduction.